Je suis infirmier. Je me lève dès potron-minet (sans jamais voir de postérieur de chat, remarquez), je bois un café bien serré, je me douche, je prends le métro à une heure où les accès ne sont pas bien plus ouverts que mes neurones, et j’arrive à l’hôpital quand les lumières du hall éclairent encore péniblement des couloirs endormis. Dans la salle de repos, sous des couettes d’un orange douteux et d’un âge certain, qui donnent des démangeaisons à la simple idée d’un contact cutané, les collègues de nuit me parlent des problèmes autour d’un café chargé de tous nous réveiller. Ça s’annonce compliqué aujourd’hui.
Je fais un premier tour, pendant lequel je demande aux patients comment s’est passée la nuit, prends leurs constantes (thermomètre dans l’oreille, brassard autour du bras, saturation au bout du doigt) et j’en profite pour piquer les bilans que les internes ont prescrit la veille, souvent sans être convaincus de l’intérêt de la chose, mais bon, « pour voir ».
Pendant ce temps, les aides-soignants ont distribué les petits-déjeuners et commencent à aider ou effectuer la toilette des patients, et à changer la literie. Une fois mon premier tour fini, je vais à la pharmacie chercher les thérapeutiques – évidemment, les trois-quarts sont prescrits en dénomination commune internationale, mais dans les armoires du service, les médicaments sont classés par noms commerciaux ; ça revient à chercher une aiguille de foin russe dans un magasin japonais.
Les internes arrivent, je vais leur transmettre les nouvelles concernant les 14 heures qui viennent de s’écouler. Ils m’amusent : ils ont l’impression d’être toujours là, parce qu’ils restent de 9h à 19h, mais ils oublient qu’une journée ne dure pas 10 heures. Bref, ils ont toujours l’air surpris d’apprendre que les patients ont continué de vivre en leur absence.
Maintenant que j’ai fini les transmissions, je prends les dossiers pour finir de préparer les médicaments, avant que les internes ne se les accaparent. Une fois les médicaments délivrés, je me sers un troisième café vers 10h30 quand toutes les chambres et les couloirs sont lavés par les ASH (agent de service hospitalier) et que les internes monopolisent les dossiers. Le temps que je m’assois, il y a déjà un médecin qui me demande de bien vouloir débuter telle antibiothérapie, et un patient qui sonne pour aller aux WC. Les aides-soignants ont fini leur tour des toilettes, et s’apprêtent à distribuer le repas du midi : il va falloir que je fasse également ma préparation des médicaments du midi, ça ne finira jamais…
Evidemment, il y a des modifications thérapeutiques, il va encore falloir que j’aille à la pharmacie. Je fais le tour, je relève les bilans pour demain sur un logiciel aussi intuitif qu’un Boeing 747 assemblé par un enfant de 5 ans dans une usine spécialisée dans les boîtes de thon. Je vais manger, puis faire les transmissions à l’équipe d’après-midi, et ma journée de travail s’achève enfin…
***
Je suis interne. Je me lève à 7h, je bois un chocolat chaud réchauffé au micro-ondes, je m’habille (me suis lavé hier soir pour me lever le plus tard possible), je prends le métro à l’heure de pointe, et j’arrive à l’entrée de l’hôpital quand des patients sont en train d’allumer leur première cigarette. Dans le poste de contrôle, à côté du tableau chargé d’étiquettes correspondant aux différents soins de la journée, les infirmiers me parlent des problèmes de la nuit et du matin. Ça a l’air d’aller.
Je fais un premier tour où je demande aux patients comment s’est passée la soirée, je les examine (inspection des constantes, palpation de mollets, auscultation cardio-pulmonaire) et j’en profite pour prescrire des bilans pour demain, pour vérifier l’évolution du syndrome inflammatoire.
Pendant ce temps, mes collègues aides-soignants ramassent les plateaux-déjeuners des patients, et continuent les toilettes. Je n’avance pas dans mon premier tour, parce que les infirmiers ont pris les dossiers pour préparer les médicaments à la pharmacie. Je ne sais pas comment ils font pour y passer autant de temps, ce n’est pourtant pas compliqué, j’écris même tout en dénomination commune internationale pour les aider. Faudrait vraiment qu’on parle de ce problème.
Quand même, c’est fou ! Je passe vraiment toute ma vie à l’hôpital, mais il arrive toujours à se passer un truc nouveau avec les patients quand je suis chez moi la nuit. Ne peuvent-ils pas dormir ? Maintenant que j’ai récupéré les dossiers, j’aimerais demander aux infirmiers de débuter une nouvelle perfusion, mais ils sont en pause café. Le temps que j’aille gentiment leur demander, les ASH ont lavé la chambre de la patiente que je voulais voir. Je passe à la suivante, mais elle est en examen. Bon, je vais prescrire des bilans biologiques pour demain, histoire de voir un peu… Et voilà que les aides-soignants s’apprêtent à distribuer le repas de midi : je n’arriverai jamais à finir mon tour…
Je propose quelques modifications thérapeutiques mineures. Je finis mon tour, je vais vérifier tous les bilans sortis ce matin, dont la moitié sortent pour dire qu’ils sont « en cours », ce qui est aussi utile qu’un accès aveugle dans un cinéma. Encore un petit point sur dossier avec la chef, et la matinée s’achève enfin…
***
Je suis M. Patient. On me réveille à 7h, on me sert un café très noir, avec lequel je tâche ma blouse qui fait de moi un potron-patient, puis je reste au lit avec les lumières toutes allumées. Dans ma chambre, mes draps brodés au nom d’un centre hospitalier qui se trouve à 100 km de là (mais qui doit profiter de la même lingerie centrale) me donnent envie de m’évader. Vu que les fenêtres ne s’ouvrent pas, j’allume la seule qui apporte image et son : la télé. Les gens parlent de moi avant d’entrer dans ma chambre. Ça a l’air grave, enfin, je ne sais pas trop ce que j’ai : un truc avec hérisson et pelle je crois, en tout cas, ça fait mal à la jambe.
L’infirmier fait un premier tour et me demandent si la nuit s’est bien passée. J’ai dit que ça allait, sauf le voisin qui a crié à un moment, le matelas qui me donne mal au cou, et les bras qui fourmillent au réveil. Il me colle un brassard sur le bras, un bidule en plastique sur le doigt, un thermomètre dans l’oreille et me fait une prise de sang. C’est bien, on est bien surveillés à l’hôpital. Le médecin de ville, il ne me fait jamais de bilan, mais ici on sent qu’on n’est pas là juste « pour voir ».
Pendant ces tortures du matin, il y a un aide-soignant qui est venu m’apporter le petit-déjeuner. Il m’a demandé comment s’était passée la nuit, j’ai dit que ça allait, sauf le matelas qui me donne mal au cou, et aussi mes bras qui fourmillent.
L’infirmier revient m’apporter les traitements. Plus tard, l’interne toque et entre dans la chambre à son tour. Il a un dossier dans les bras, mais ce n’est pas le mien. Il bafouille deux-trois mots pour lui-même en se disant qu’il noterait plus tard et que la chambre d’à-côté est mouillée. Il me demande comment s’est passée la nuit, je réponds que ça va, sans plus de précisions, pour éviter qu’il ne me garde plus longtemps. Il m’ausculte le dos, me parle un peu de mes orteils et de mon diabète, me palpe les mollets comme si j’étais un cheval de course qu’il s’apprête à acheter, et puis s’en va.
Maintenant que j’ai fini d’être examiné, je prendrais bien un deuxième café, mais je n’ose pas demander. Et puis j’aimerais bien aller aux toilettes, mais je vois bien que tout le monde est occupé. Il y a une femme qui vient nettoyer ma chambre et me demande comment s’est passée la nuit. Quelqu’un toque : l’interne voulait revenir avec le bon dossier pour me reposer « quelques petites questions », mais maintenant il ne peut plus parce que c’est mouillé. Il me dit qu’il repassera, mais vu qu’il ne le fait déjà pas pour ses vêtements, j’ai des doutes. L’infirmier revient ensuite ajouter une poche de liquide, en me disant que c’est pour ma jambe rouge. Je ne lui dis pas, mais en fait, c’est sur mon bras qu’il le branche.
Évidemment le midi, on a encore changé mon traitement. De toute façon, à la maison, j’arrêterai tout ça, parce que là il y en a trop et ça me fait mal au ventre. Enfin, je ne leur dis pas, ça va encore retarder ma sortie. Je finis mon tour de zapping des chaînes, et la matinée s’achève enfin…
Cet article a été publié le le jour de la fin du monde (21 décembre 2012) sur infirmiers.com (et sur leur compte Facebook du coup).
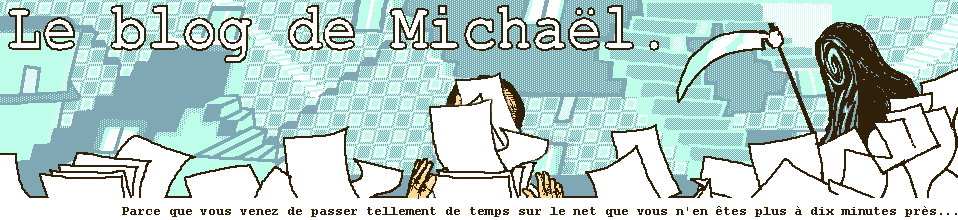



{ Laisser un commentaire }