La santé subit tous les mois des critiques médiatisées, qui ne sont que des variations sur le thème « les médecins et les patients sont des irresponsables, et heureusement que les politiciens sérieux sont là pour y mettre du bon ordre ».
Les gens consultent trop mais il n’y a pas assez d’accès aux soins.
Les médecins prescrivent trop mais sont en-dessous de chaque objectif de santé publique lié à une prescription.
Les arrêts de travail sont trop longs, même s’ils sont systématiquement validés à partir de 6 mois.
Etc.
Les responsables sont toujours les patients, les médecins (surtout généralistes), parfois les infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes… en tout cas, absolument jamais les dirigeants en place ! Parfois, quand même, les responsables concèdent que « leurs prédécesseurs » ont pu faire des erreurs… mais c’est une constante : le gouvernement en place ne se trompe jamais.
Lutter contre les mensonges instantanément…
Dans ce contexte, de nombreux citoyens — professionnels de santé ou non — démentent régulièrement les critiques infondées, erreurs involontaires, raccourcis voire manipulations éhontées des dirigeants de tout bord politique.
Mi-Cassandre, mi-Sisyphe, nous dénonçons vainement les problèmes actuels et à venir (dans les propos et décisions politiques), et sommes contraints de le refaire sans cesse.
Par exemple cette semaine, le ministre de la santé a dit sur une radio que « 50 % des arrêts de travail > 18 mois sont injustifiés » sans trembler des genoux — et surtout sans expliquer qu’une part non négligeable de ces contrôles ciblés sont en fait des arrêts de travail interrompus par le médecin conseil, notamment pour passer le patient en… invalidité. Il s’agit donc d’une « injustification » dans un tableur Excel (parce qu’on ne peut pas être en arrêt et en invalidité), mais évidemment d’un arrêt parfaitement « justifié » dans le langage du commun des mortels.
Malgré les nombreux commentaires explicatifs sur les réseaux sociaux, il n’a évidemment proposé aucun correctif, et a répété la même erreur (de la même fiche de synthèse) 2 jours plus tard à la télé..
C’est insupportable et ça génère (pour ma part) de la colère. Ainsi, les médecins râlent, protestent, militent — seuls localement, sur les réseaux sociaux, en association, en syndicat… mais ces corrections par les médecins généralistes ont deux limites majeures.
La première limite concerne l’espace. Lorsqu’une information erronée est donnée dans la presse (écrite, radio, TV), elle touche un large public, et est souvent relayée par le compte Twitter, Facebook, Instagram, BlueSky de la chaîne et/ou de la personne qui l’a lancée et/ou d’un proche, du même parti… c’est impossible de pouvoir la démentir partout. « Lie finds a way », pour paraphraser le Docteur Malcolm de Jurassic Park.
Le rectificatif arrive lui plus tard et dans un espace plus restreint : la visibilité des médecins sur les réseaux sociaux reste limitée, puisqu’ils fonctionnent avec un défilement illimité… Sur X, une réponse argumentée et sourcée (qui fait quitter l’application par des liens) disparaîtra d’autant plus rapidement dans les limbes du scroll infini, et sera à peine visible.
Ainsi, le démenti touche (quasi) systématiquement une portion de gens moindre que celle qui a été exposée à l’erreur.
La deuxième limite concerne le temps. On ne peut se contenter de dire « le ministre se trompe » sans argumenter, puisque l’argument d’autorité lui bénéficie à lui (sauf si vous êtes le Président à la rigueur).
Cela demande d’aller vérifier ses informations, consulter plusieurs documents, faire des captures d’écran, mettre un lien, faire preuve de pédagogie ou de clarté… C’est la loi d’Alberto Brandolini (2013) ou principe d’asymétrie du baratin : « la quantité d’énergie nécessaire pour réfuter des sottises est supérieure d’un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire ». De façon plus imagées, citons John Arbuthnot : « le mensonge vole, la vérité le suit en boitant » (L’Art du mensonge politique, 1733)… ou encore Terry Pratchett : « Les mensonges pouvaient faire le tour du monde le temps que la vérité enfile ses chaussures » (Les annales du Disque-Monde, La vérité, 2000).
Lorsque vous démentez une information, non seulement vous touchez une portion moindre de gens qui y ont été exposés… mais en plus, pendant votre argumentation, les mêmes responsables ont ajouté de nouvelles approximations ! Et ils ne répondront jamais à la correction que vous avez apportée, car ils sont déjà passés à autre chose…
Par exemple, aujourd’hui, qui se souvient qu’Emmanuel Macron faisait le voeu suivant aux soignants : « on a 600 000 patients avec des maladies chroniques qui n’ont pas de médecin traitant. Et ça, c’est un vrai problème parce que c’est une perte de chance (…) [Ils] se verront proposer un médecin traitant avant la fin de l’année » ?
C’était le 6 janvier 2023, et 2 ans après, absolument personne ne lui remet ces propos sous les yeux pour demander des comptes — qu’il n’a jamais rendus, et ne rendra jamais. C’est un sujet que nous reverrons dans un prochain billet.
… ou prendre son temps de mieux informer…
Démentir sur les réseaux a quelque chose de satisfaisant dans l’immédiat : c’est relayé a minima, et nous participons à corriger une fausse impression auprès de quelques centaines ou milliers de personnes.
Mais c’est probablement insuffisant pour les raisons sus-évoquées : la correction touche moins de personnes que le mensonge, et occupe un temps démesuré à réagir au détriment du temps disponible pour proposer ou vulgariser.
Et ce travail chronophage est frustrant : à chaque fois, il faut répéter la même chose, sans pouvoir se référer à une réponse claire, construite, sourcée… Il faut reprendre les mêmes documents, ré-extraire les mêmes chiffres, pour apporter une réponse structurée.
Pour éviter cette répétition, il faudrait pouvoir garder ailleurs ces réponses de fond, et y améliorer la vulgarisation, l’argumentation, en essayant d’anticiper les attaques futures contre la santé…
Le lieu idéal pour ces « réponses de fond », structurées, n’est donc sûrement pas les réseaux sociaux, où elles se perdent dans le défilement infini.
Ce n’est sans doute pas non plus un essai (qui ne sera lu que par quelques dizaines ou centaines de personnes), ni un Substack payant, ni un wiki (chronophage à gérer)… Sans doute ce lieu idéal n’existe pas et il n’est pas très utile de le chercher ailleurs qu’au plus simple : en l’occurrence pour moi, ce blog… Un lieu simple, ouvert, gratuit.
… sans se leurrer.
Ne nous leurrons pas sur l’objectif : écrire des articles longs n’est pas mieux que réagir à chaud, et ne doit pas le remplacer.
Déjà, on ne milite pas vraiment pour faire changer directement un décideur politique, mais pour informer.
Les « propositions » seront encore moins écoutées que les réactions (nous en avons fait sur de nombreux sujets, en prévention, sur la qualité de l’air, sur les certificats absurdes ou bien d’autres sujets).
Après 5 ans de « militantisme » divers et varié (toute proportion gardée pour ce terme, quand il s’agit d’écrire sur un clavier quand même), j’ai bien compris que nul citoyen lambda ne peut détourner un politicien de son projet, aussi stupides puissent-t-il être.
Il ne s’agit donc pas de faire changer d’avis tel ou tel ministre ou président, mais plutôt d‘améliorer la qualité du débat public en retenant quelques chiffres clés et en proposant quelques références (officielles)…
Que ce soit sur X, Facebook, LinkedIn, Instagram ou ailleurs, l’intérêt principal du « militantisme » est avant tout égoïste : il s’agit au moins de se donner l’impression d’avoir partagé une information, d’avoir fait quelque chose d’utile pour l’information et pour l’intérêt général… en gardant bien sûr l’espoir que cela aura réellement un impact pour la santé publique.
En réalité, il faut sans doute pouvoir faire les deux : une note de synthèse un peu intemporelle, facilitant les réactions à chaud… qui elles-mêmes alimentent la synthèse.
Restent deux problèmes.
Le premier est celui de la légitimité : il existe de vrais spécialistes de la sécurité sociale, historiens, sociologues, économistes de la santé, épidémiologistes, syndicats, etc. Clairement, je n’ai pas de légitimité particulière pour ça, et je ne vais pas passer les billets suivants à m’en excuser pour éviter toute lourdeur… Tout ce qui suivra sera mon avis, lié à ma formation, mes lectures, ma pratique de 10 ans de médecine générale.
Le deuxième problème, central, est celui du temps. Nous manquons de temps pour soigner, pour se former, pour commenter les choix économiques ou politiques, pour faire entendre nos voix, pour proposer des idées pour améliorer l’état de notre système de santé… C’est pour ça que les billets seront publiés à un rythme… qui reste à définir. Puisse au moins ce prologue clarifier ce que je souhaite écrire !
(PS. J’ai mis un titre « Enchanter la santé » parce que « réparer la santé » ou « la santé en chantier » sont déjà pris, et parce que j’aime bien les jeux de mots).
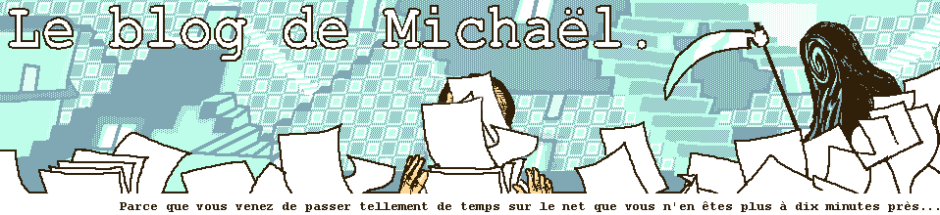

Nous avons réagi, souvent, nous avons parfois milité, travaillé, voté, écrit, accueilli, pétitionné, souhaité une meilleure prévention, soutenu des politiques sociales, encouragé des réformes fiscales et nous en sommes là, au seuil d’une jungle effrayante où l’État social, protecteur et puissant se délite où chacun doit s’adapter aux pires scénarios, se défendre et maintenant s’armer…