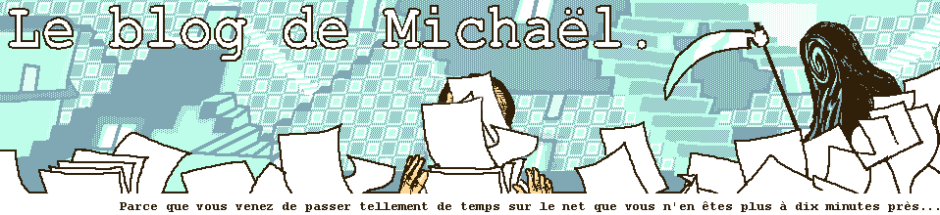Dimanche dernier, Thomas Mesnier (député et urgentiste) a envoyé ce tweet avec une quinzaine de Twittos en copie :
Le texte intégral est disponible ici. Je vous préviens, c’est un peu longuet à lire, et comme toujours dans ces textes, les diptères n’en sortent pas indemnes. Mais allons-y pour une lecture (courte) avec avis (court, mais pas trop).
J’avais déjà donné un premier avis ici… [Spoiler, il n’a pas trop changé depuis…]
Déjà, on peut se poser la question de l’intérêt d’une procédure accélérée pour réformer le système de santé. Je n’y connais pas grand-chose en législation, mais quand on commence un texte par « ça date des Trente Glorieuses » + « franchement on s’en sort pas si mal à l’heure actuelle », je ne comprends pas bien l’intérêt d’une procédure diminuant les discussions parlementaires. La même question va se retrouver plusieurs fois dans le texte avec la mention des « voies d’ordonnance ».
Je note une phrase très intéressante dans l’introduction :
Il convient de partir des besoins des patients et des professionnels de santé, qui sont les meilleurs experts de leur situation.
Article 1er : La suppression du numerus clausus
Alors quand je parlais de souffrance diptérienne, je pensais déjà à cet article qui « rénove le mode d’accès aux études [de santé] en supprimant le numerus clausus (…) L’ensemble du processus demeurera exigeant et sélectif (…) le nombre d’étudiants formés dans les études de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique sera déterminé dans le cadre de modalités de régulation profondément réformées, tenant compte des capacités de formation et des besoins du système de santé, et reposant sur une concertation étroite entre les universités et les agences régionales de santé. »
En latin, Numerus Clausus, ça veut dire « Nombre fermé (d’étudiants admis) ». Donc dire « on va arrêter de fermer le nombre d’étudiants au niveau ministériel pour le fermer au niveau des ARS, antennes régionales du ministère de la santé », c’est au mieux étrange (est-ce qu’avant le ministère ne tenait pas compte des avis de l’ARS ?)
Article 2 : la suppression des ECN
Après un constat sur un deuxième orienté vers la préparation des ECN (vrai) au détriment de compétences cliniques et relationnelles (vrai), le projet de loi annonce d’un « nouveau système [qui] permettra l’admission des étudiants ayant satisfait à la réussite d’épreuves permettant d’évaluer les compétences et connaissances acquises (…), ainsi que leur parcours de formation et leur projet professionnel. »
Donc comme déjà dit dans mon premier avis, on remplace des épreuves classantes nationales par des épreuves qui seront à la fois classantes, mais également probablement nationales (comme on supprime le numerus clausus pour le remplacer par un nombre, mais fermé).
En partant d’un excellent objectif (juger sur les compétences cliniques), on ajoute de la désanonymisation : on diminue ainsi encore le semblant d’égalité qu’il y avait dans les ECN, en ajoutant des notions vagues comme « le parcours de formation » (un master 1 ? un master 2 ? une thèse de science ?) et le « projet professionnel » (une lettre de motivation suffira t-elle ou faudra t-il un engagement d’installation en zone sous-dotée ?). Et diminuer l’égalité, c’est vraiment très moche.
Article 3 : recertification des compétences
Le Gouvernement va pouvoir, « par voie d’ordonnances » (ils ont un problème avec le Parlement ?) prendre des mesures de re-certification. C’est un beau projet.
J’ai un peu de mal à savoir qui va recertifier les compétences des généralistes par exemple ; et qui recertifiera les compétences des re-certifieurs… Par ailleurs, à cause du NC et de son évolution dans les années 80-90 (et uniquement à cause de lui), on se retrouve en période un peu creuse, démographiquement parlant ; on peut donc se demander si c’est le bon moment pour lancer des vagues de recertification ?
En pratique, en 2019, les professionnels de santé disposent d’une enveloppe annuelle permettant de suivre 1 à 3 formations de « développement professionnel continu » (DPC) (enveloppe de 173 M€ dont 90M€ pour les médecins). Ça paie la formation et dédommage de l’absence au cabinet. Il y a plus de 15 000 formations existantes. Sur les 220 000 médecins en France, environ 51 000 suivent au moins une formation (25 %). Malgré cela, en septembre, l’enveloppe nationale est grillée.
Je sais que ça n’est pas ça, la recertification… mais si on n’arrive pas à donner les moyens nécessaires pour continuer à former plus de 25 % des médecins, vouloir ajouter une couche au gâteau me semble faire preuve d’une folle assurance.
Article 4 : le CESP étendu
Je ne maîtrise pas assez le sujet, je ne commente pas.
Article 5 : médecin adjoint
Un interne en médecine va pouvoir être promu médecin adjoint en cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel (normalement réservé aux zones touristiques, ce dispositif sera étendu dans les zones avec difficultés d’accès aux soins).
Là encore, je ne maîtrise pas assez le sujet, je ne commente pas (j’imagine juste que c’est réservé aux internes ayant les pré-requis nécessaires pour remplacer).
Article 6 : statut de PH
Là encore, « par voie d’ordonnances », le Gouvernement va pouvoir créer un statut unique de PH et supprimer le concours, pour « renforcer l’attractivité de l’exercice ».
Je comprends l’idée de supprimer un concours qui n’en est pas vraiment un, mais je ne suis pas sûr qu’un des principaux messages des médecins soit « oh là là, il faut supprimer ce (pseudo) concours de PH, c’est vraiment un besoin ». Parce que je rappelle :
Il convient de partir des besoins des patients et des professionnels de santé, qui sont les meilleurs experts de leur situation.
Article 7 : Projet territorial de santé
Pour « décloisonner ville – hôpital – médico-social », « les projets territoriaux de santé (PTS) des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) sont soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé afin d’assurer leur coordination avec les autres acteurs du système de santé« .
Et donc, je rappelle encore :
Il convient de partir des besoins des patients et des professionnels de santé, qui sont les meilleurs experts de leur situation.
J’en déduis que des professionnels de santé ont donc dit quelque part : « huuuum, on aimerait beaucoup s’organiser en CPTS, préparer des réunions, rédiger des dossiers que le DG de l’ARS devra approuver, pour qu’on puisse continuer à faire ce qu’on faisait avant, mais de façon supervisée par cet administratif à 150 km de chez nous avec un délai de traitement des dossiers de l’ordre du trimestre, et avec moins de temps à cause de celui perdu dans des réunions pour rédiger ces dossiers, et aussi redonnez-nous un peu de cyanure s’il vous plait ».
Il y a des dizaines de choses à envisager pour ces CPTS : sur le principe, c’est intellectuellement intéressant. Mais quand le seul truc mis dans ce projet c’est « tout projet devra être approuvé par le DG de l’ARS », j’ai l’impression d’une mauvaise blague.
Faisons simple : on a une pénurie de boulangers ; pour améliorer la qualité de la boulangerie en France, le ministère des boulangers dit « vous allez vous réunir et chaque groupement pourra ainsi mieux répondre aux attentes locales, parce qu’on sent que c’est une grosse attente des gens ça (les gens ne veulent pas seulement du pain, ils veulent que les boulangers se coordonnent, c’est bien connu) ».
Bon.
A ce stade, les boulangers devraient déjà dire « euh on a pas le temps, on doit faire du pain », ce qui est légitime. Mais si en plus le seul truc que le ministère des boulangers met dans la loi c’est « le contenu de vos réunions devra parvenir à l’antenne régionale du ministère de la boulangerie qui décidera si ce que vous, boulangers locaux d’un territoire X, jugez pertinent, ça l’est vraiment (on vous connait les loustics, toujours prêts à faire des réunions pour des trucs inutiles) », normalement ça devrait passer moyen dans le milieu du petit pain au chocolat.
Enfin, rappelons que quand on parle de décloisonnement, on a toujours l’impression que c’est la ville qui doit se décloisonner (maisons de santé pluriprofessionnelles, CPTS…) pour se rapprocher de la structure hospitalière. On a parfois l’impression que l’hôpital est le modèle de soin… mais la réalité c’est que la plus grande partie de la médecine se fait dans nos petits cabinets avec un(e) médecin, un(e) patient(e), un ordinateur, une box, un téléphone. Les soins se font par des infirmiers, kinés, auxiliaires de vie et autres professionnels de santé qui s’organisent en tournées et joignables sur leurs portables directement. Notre modèle de santé, sa performance et son efficience actuelle, viennent essentiellement de là : ça n’est pas très sexy, mais deal with it.
En 2019, les médecins généralistes représentent 45 % des 226 000 médecins en activité. L’hôpital, aussi indispensable et salvateur soit-il (on fait trop peu de réanimation néonatale en médecine générale, c’est vrai – et tant mieux), est relativement rare dans un parcours de soin… donc, si on veut « re-re-re-re-placer le patient au centre du système de santé », c’est l’hôpital qui doit s’adapter aux libéraux et non les libéraux qui doivent imiter l’hôpital.
Articles 8 et 9 : la gouvernance des hôpitaux de proximité / les autorisations des activités de soins et équipements matériels lourds.
Le Gouvernement peut prendre par « voie d’ordonnances » (bis repetita) des mesures pour « redéfinir les missions et les modalités de gouvernance des hôpitaux de proximité (avec objectif de labellisation dès 2020) » et pour « autoris[er] des activités de soins et des équipements matériels lourds ».
Le but semble être de mieux grader les soins premiers (Doctissimo), secondaires (pharmacie), tertiaires (médecin généraliste), quaternaires (hôpitaux de proximité), quinquénaires (hôpitaux un peu éloignés mais de niveau supérieur, mais pas des CHU), sexténaires (CHU), septénaires (CHU, mais à Paris), octénaires (naturopathe, ostéopathe, acupuncteur, tante Germaine, concierge, etc.). Blague à part, je ne maîtrise pas bien ces articles, je ne commente pas.
Article 10 : renfoncement de l’intégration au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT)
Là non plus, pas de vrai commentaire sur le GHT, qui est hospitalier et que je ne maîtrise pas. L’article ouvre la possibilité de « mutualiser la compétence de gestion des ressources humaines, de la trésorerie » et de « signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’ARS » (ce contrat sent tellement la pomme de Blanche-Neige !)
Vu de loin, le GHT, ça a l’air d’ennuyer administratifs et médecins… Bon après, c’est peut-être pas vraiment les meilleurs experts de leur situation non plus.
Article 11 : la plateforme des données de santé (PDS)
La PDS va se substituer à l’institut national des données de santé. Bon, là, je suis partagé évidemment.
Mon moi « méfiant » qui se retrouve plusieurs fois par an avec des courriers d’assureurs véreux prêts à toute tentative filloniste pour ne pas rendre l’argent se dit « euh, une liste nationale qui permet d’identifier les patients avec des ALD ou des traitements permettant d’identifier tous les patients avec un VIH, un cancer… c’est un peu chaud quand même, ça a vraiment intérêt à être bien blindé, parce qu’on parle de secret médical ici. »
Mon moi « chercheur » (avec les guillemets hein) se dit « trop cool, une base qui va nous permettre de faire des études super cool – même si elle sera probablement très difficile d’accès et que je n’y toucherai jamais de ma vie ». Je pense que c’est l’évolution utile et nécessaire des données de santé ; on voit quand même que les grosses bases de données (PMSI, EGB, SNIIRAM…) n’ont pas été utilisées à mauvais escient à l’heure actuelle, donc pas de raison que ça ne dure pas.
Article 12 : espace numérique de santé
D’ici le 1er janvier 2022, chaque usager pourra « ouvrir son espace numérique de santé » afin d’accéder « à son DMP, des outils numériques pour échanger avec les professionnels et établissements de santé… », puis « le fermer à tout moment et détruire les données y figurant ».
Nous sommes nombreux à avoir parlé du DMP actuel, qui est une usine à gaz coûteuse inadaptée (pour faire simple), notamment parce qu’elle a eu le défaut d’oublier de partir des besoins des patients et des professionnels de santé, qui sont les meilleurs experts de leur situation (rappelons-le). Le projet d’un DMP informatisé, c’est un objectif évident pour améliorer la qualité des soins : si on pouvait faire un reboot de la santé française, il faudrait partir là-dessus. Mais on a tous des logiciels différents, en ville, à l’hôpital… dans des EHPAD voisines de 10 km, je compte déjà 4 logiciels différents. En 2019 on n’a même pas de carnet de vaccination informatisé pour tous. Et on file les clés de la prise de rendez-vous hospitalière à DocToLib (avec toutes les données que ça comporte)…
Ouvrir un espace numérique de santé, c’est cool. Si c’est vide, c’est le l’argent gâché. Mettez-le ailleurs. Merci.
Article 13 : le télésoin
Le télésoin sera la pratique à distance de consultations entre un patient et un pharmacien ou auxiliaire médical (orthoptie, orthophonie) : par exemple sont cités l’accompagnement des effets secondaires de chimiothérapies orales par des infirmières, des séances d’orthophonie à distance, des séances d’orthoptie à distance…
Je ne commente pas, ça n’est pas mon domaine.
Article 14 : la prescription dématérialisée
Le Gouvernement, par les classiques « voies d’ordonnances », pourra prendre « des mesures pour encourager le développement de l’e-prescription pour diminuer les incompatibilités et interactions, en gagnant du temps et de la coordination entre professionnels de santé ».
Plein de choses à dire là-dessus. « Prendre des mesures pour encourager », ça veut clairement dire « du bonus sous forme d’argent » ; ils ont déjà visiblement des idées assez claires sur le sujet.
L’e-prescription est déjà trèèèèès utilisée (et financièrement encouragée dans la ROSP), les incompatibilités et interactions sont déjà soulignées et régulièrement ignorées (parce que trop fréquentes).
Je crois que ça n’est pas spécialement une demande des médecins pour « un gain en termes de temps » (ils préfèrent cliquer sur « imprimer » que faire 30 manoeuvres informatiques pour valider l’envoi d’une ordonnance sur une plateforme qui n’existe pas encore par exemple).
Je ne crois pas non plus que ça soit un gain de temps pour les pharmaciens, encore que ça pourrait leur permettre de préparer l’ordonnance en amont (mais bon, le temps de préparation reste le même, avec le patient qui poireaute ou pas…).
M’est avis que ça n’est pas non plus une demande des patients (qui sont bien contents de pouvoir se faire dépanner d’une boîte en avance de temps en temps…)
Quant à la coordination, il existe depuis 1876 une invention hyper pratique qu’on nomme assez communément « téléphone » et – ça peut sembler flou -, il arrive plusieurs fois par semaine que les médecins et pharmaciens se « décloisonnent par voie téléphonique ». Le projet censé « décloisonner » les gens va donc probablement remplacer à terme un contact téléphonique par une alerte sur un logiciel de partage d’ordonnances, qu’on consultera chaque jour comme on consulte nos résultats biologiques : je trouve ça cocasse ^^
Bref, oui, c’est moderne, c’est écologique et économique en papier et encre, ça évite les pertes d’ordonnance, ça permet de mieux suivre l’observance et le nombre de boîtes délivrées, ça permettra sans doute d’éditer plus facilement une ordonnance si besoin. Perso, j’aime bien l’idée, mais ça n’est pas la peine de nous enfumer avec des histoires de « gain de temps et coordination ».
Article 15 : abrogation de dispositions obsolètes
Cet article abroge 4 dispositions inappliquées ou obsolètes. Ok.
Article 16 : sécurisation et simplification du cadre financier et comptable des établissements de santé
Cet article va « assouplir les règles de comptabilité devant être adoptées par les établissements de santé ».
Je ne maîtrise pas.
Article 17 : création d’une surveillance nationale des IVG par les bases de données numériques
Les bulletins statistiques remplis manuellement par les centres d’IVG (et professionnels de santé) sera remplacé par le suivi dans les grandes bases de données. C’est logique ; probablement qu’on perd un peu d’informations, mais qu’on en gagne d’autres.
Article 18 : 5 mesures de simplification pou les établissements de santé
Je ne maîtrise pas, ça parle de difficultés sous contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les opérations de transformations, le périmètre de captage des eaux, les compétences « des agences régionales de santé et des responsables de piscines » (sur le même plan, mais WTF ?!), et le code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires.
Article 19 : simplification et harmonisation
Par voie d’ordonnances (…), le Gouvernement va pouvoir :
- simplifier les modalités d’exercice des missions des ARS, la modification de leur organisation et leur fonctionnement,
- favoriser le développement de l’exercice coordonné par des CPTS et des maisons de santé pluri-professionnelles (MSP),
- créer l’ARS de Mayotte et l’ARS de La Réunion, à la place d’une seule grande ARS Océan Indien
Article 20 : renforcer la préparation aux situations sanitaires exceptionnelles
Je ne maîtrise pas…
Article 21 : rénover les modalités de recrutement des praticiens à diplôme étranger hors UE (PADHUE)
Idem.
Article 22 : permettre le développement des activités de la HAS à Wallis-et-Futuna et à l’international
Idem.
Article 23 : ratification de 30 ordonnances de modernisation du système de santé.
Idem.
Et voilà.
Je ne sais pas si vous vous souvenez mais j’avais relevé une phrase intéressante dans l’introduction :
Il convient de partir des besoins des patients et des professionnels de santé, qui sont les meilleurs experts de leur situation.
Visiblement donc, les patients ont besoin d’ouvrir un dossier informatisé et ne plus avoir d’ordonnances au format papier. Les médecins ont besoin de faire des réunions entre professionnels d’un même territoire et faire valider tout ça par l’ARS.
…
Si ce projet de loi est ce que le Gouvernement a entendu des besoins des uns et des autres, je crois qu’il y a des diagnostics gratuits et rapides chez Amplifon. Remarquez, c’est dommage, parce que les appareillages ne sont pas remboursés… ça c’est une demande des patients, un vrai besoin.
Des « besoins de patients et professionnels de santé », il y en a plein d’autres :
- Développer et revaloriser les structures de soins à domicile : nulle part il n’est question ici des 120 000 infirmiers à domicile (revalorisation des actes et frais de déplacement, nouveaux actes de prévention, d’éducation et prise en charge comme dans la fin de vie – comme proposé par leur Ordre), des structures de soins infirmiers à domicile (ouvrez des SSIAD et donnez leur de l’argent), de kinésithérapie (qui ont aussi des propositions pour les hospitaliers), d’auxiliaire de vie, d’orthophonistes (qui ont aussi des propositions), des équipes de soins Alzheimer à domicile (ESAD ; rembourser plus que 15 séances annuelles de stimulation cognitive en cas de troubles neuro cognitifs par exemple…), etc.
- Revaloriser le rôle des pharmaciens au-delà la simple « coordination » par réception d’ordonnance électronique (dans la coordination ville-hôpital, avoir un « pharmacien référent » pourrait être une bonne solution pour éviter les interactions… c’est un peu plus réaliste en 2019 qu’attendre le DMP).
- Rembourser la psychothérapie (pas la psychanalyse hein), l’ergothérapie, les lunettes et appareils auditifs donc, les soins dentaires…
- Développer le sport sur ordonnance…
Comme tout ça demande des sous, il y a des solutions pour en récupérer :
- Commençons par rappeler qu’il existe une polémique en cours sur l’homéopathie et les FakeMed : que si on les déremboursait, ça permettrait de libérer du temps médical, de récupérer de l’argent public pour réinvestir dans d’autres soins mieux éprouvés… (On sait que vous avez piscine, mais il va falloir trancher)
- Faire de l’information grand public sur les consultations les plus fréquentes pour les médecins généralistes. Il y a beaucoup de consultations pour « fièvre H6 mais j’ai pas pris de paracétamol sans votre avis », « rhinopharyngite persistante et vous êtes vraiment sûr qu’il ne me faut pas des antibiotiques parce que ma tante Germaine elle m’a dit que si », « gastro-entérite J4 j’ai rien mangé et bu que de l’eau c’est quoi un soluté de réhydratation », « lombalgie J6 finalement j’ai pas bougé comme vous m’aviez dit j’ai préféré rester allongé mais c’est pire »… C’est quand même dommage, parce qu’il y a des messages simples et clairs à faire passer, qui pourraient diminuer un peu le nombre de consultations de tous les médecins.
- Arrêter de demander des arrêts de travail pour les jours de carence. Les travailleurs ne sont pas des enfants ; leurs médecins ne sont pas leurs parents. Si vous avez peur que les travailleurs « abusent » de ces 3 à 5 jours que vous leur offrirez dans l’année, dites-vous que ça n’est que compensation des arrêts de travail que la plupart des autres n’auront pas pris.
- Développer et clarifier le rôle des (très proches) infirmiers de pratique avancée qui diminueront les dépenses médicales… et par pitié, prévoir leur cursus avec des universitaires de médecine générale (« experts de leur situation » de soins primaires) et non seulement avec des praticiens hospitaliers comme c’est le cas actuellement et qui, par définition (et le fucking carré de White) ne connaissent pas « les patients ambulatoires » mais le sous-effectif des « patients qui ont souvent bénéficié d’une prise en charge en ambulatoire mais finissent par être hospitalisés »
- Arrêter de demander des certificats dépourvus de sens. Arrêtez avec vos dossiers MDPH de 8 pages pour avoir une carte de stationnement : de toute façon, vous ne regardez que le périmètre de marche pour ça… Si vous voulez limiter les abus, déplacez-vous chez les gens ; si vous n’avez pas les moyens de le faire, arrêtez de faire chier patients et professionnels de santé. Vous claquez des sommes monstrueuses pour pouvoir refuser 1 carte de stationnement sur 3, ce qui emmerde un patient et le limite dans sa vie, tout ça pour avoir tous les jours des dizaines de places « handicapées » vacantes sur les parkings de supermarché, c’est quoi votre délire ? Vous croyez que les gens demandent une carte avec leur photo et « personne à mobilité réduite » à côté pour faire joli sur leur pare-brise ? Arrêtez aussi de faire des demandes d’APA par le médecin traitant pour ensuite la faire refaire par une infirmière du conseil général, ça fait doublon, ça fait perdre du temps, de l’énergie et de l’argent.
- Non, il ne va rien se passer chez quelqu’un qui pratique la pétanque en compétition ; oui, un patient de 15 ans peut participer à un tournoi d’échecs. Laissez les gens vivre. De toute façon, malgré les certificats, il y a toujours des coureurs professionnels qui décèderont en courant un 10 km ; et les patients viennent nous voir 3 jours avant leur course, ils s’entraînent depuis 2 mois pour la faire… On ne fait rien pendant ces examens, on contrôle la tension artérielle, on ausculte, on pose 2-3 questions qu’on avait normalement déjà dans le dossier. « Certifier » qu’un patient est apte pour le sport, c’est faire mentir le médecin, faussement rassurer le patient et les organisateurs. Si vous voulez des consultations de prévention, organisez des consultations de prévention pour tout le monde… mais… (transition)
- … mais arrêtez de faire faire les consultations de prévention dans des centres avec des gens qui font ça comme des robots et font une audiométrie, un ECG, une spirométrie et un bilan « exhaustif » à tout le monde. Par pitié, envoyez-les chez leur médecin traitant pour faire ça, sinon comment voulez-vous qu’on existe au patient qu’on « rationnalise » ses bilans biologiques ? Vous avez trop d’argent ? Regardez la liste ci-dessus !
Mais dites donc, tout ça fait plein de propositions. Eh oui ! Ca tombe bien, il y a une semaine, le Dr Jean-Baptiste Blanc (@Dr_JB_Blanc) a lancé une pétition, pré-signée par 100 d’entre nous, avec des propositions concrètes, dont plusieurs citées ci-dessus. Farfadoc en a parlé dans un billet de blog tout récemment aussi !
N’hésitez surtout pas à signer cette pétition. Ca serait dommage de ne pas contribuer à simplifier la vie des patients et médecins généralistes !
(Je devais twitter ça demain à 7h30 comme d’habitude, mais en hommage à l’heure de tweet de notre député, je vais le publier aussitôt ^^ Vu l’heure, j’ai mal relu, désolé si l’ironie et le cynisme passent parfois mal ou trop lourdement. Je ferai plus léger la semaine prochaine.)
Oh, et cette fois, si le Gouvernement est pressé de mettre en place ces quelques mesures proposées par des professionnels de santé experts de leur situation, il ne faut surtout pas hésiter à utiliser la voie d’ordonnances qui lui est si chère 😉